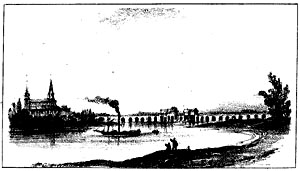Le développement de la navigation (de 1790 à 1850)
La première partie du texte suivant est extraite d'un document
rédigé par F. Boulé, intitulé "LES TRANSPORTS
EN COMMUN PAR TERRE ET PAR EAU EN SEINE ET OISE DE 1790 A L'ETABLISSEMENT
DU CHEMIN DE FER".
Les coches d'eau
Les transports par eau de beaucoup plus économiques étaient très en faveur. L'approvisionnement de Paris en denrées, blés, vins, charbon, bois etc. se faisaient en grande partie de cette façon.
En 1790, les diligences royales de Paris à Rouen établies par arrêt du conseil du 19 janvier 1778 partaient du port Saint-Nicolas tous les samedi chargées complètement ou incomplètement et n'étaient en route que huit jours au plus ; toutefois en cas d'abondance des marchandises des départs supplémentaires avaient lieu. L'on chargeait pour Le Pecq, Poissy, Triel, Meulan, Mantes, Rolleboise, Bonnières etc.
Les coches d'eau de la Haute-Seine, quai Saint-Paul, allant à Montereau, s'arrêtaient à Corbeil. Ce moyen de transport était ancien et très populaire. Déjà en 1632 en raison de son arrêt à Corbeil on avait surmonté le coche, corbillas ou corbillard et il avait été choisi comme sujet d'un ballet intitulé "Le Corbillas aux Dames".
La concurrence des voitures commençant à se faire sentir, la maîtresse du coche disait : "Ma pratique se perd et désormais je vois que mon bateau ne va que pour les femmes grosses ; cette disgrâce vient du nombre des carrosses. N'en est-il point de vous qui s'en plaignent avec moi".
Pendant le trajet l'on pouvait se restaurer à son aise car il y avait à bord une petite taverne.
La tenue des passagers et des bateliers n'y était pas toujours du meilleur ton. Ce fut d'ailleurs sur un bateau semblable que le Vert-Vert de Gresset fit son fatal voyage de Nantes à Nevers en compagnie de deux nymphes, une nourrice, trois dragons et deux gascons. Il y perdit sa première innocence.
Cependant sur ce parcours de nouvelles diligences d'eau plus décentes et plus propres furent établies en 1799 par la nouvelle Agence Générale des Coches d'eau de la Haute-Seine, de l'Yonne, des canaux du Loing et de Briare. Ces galiotes étaient construites d'après le modèle des yacks de Hollande, décorées de peintures agréables, de croisées avec persiennes, distribuées en salle commune et cabines ; les sièges étaient garnis de coussins de crin et de velours. Une balustrade en fer faisait le tour du tillac. De plus les commis ambulants, les pilotes et les mariniers étaient choisis avec soin. Les nourrices, les défenseurs de la patrie et les bateliers continuèrent de bénéficier des prix de faveur mais seulement sur les coches.
Au port Saint-Paul l'on embarquait pour Corbeil, Montereau, Nogent et Briare ; au port Saint-Bernard pour Auxerre et Sens. Des bateaux couverts avec des abris fermés pour les marchandises étaient attachés aux coches d'Auxerre. A Valvins des diligences menaient de suite les voyageurs à Fontainebleau et à Montereau, d'autres conduisaient à Auxerre et Troyes.
Deux galiotes faisant le service entre Paris, Sèvres et Saint-Cloud.
A Poissy il en partait une tous les jours à midi pour Rolleboise ; celle de Rolleboise arrivait à Poissy vers six heures du matin.
Les bateaux à vapeur
Cependant les transports fluviaux allaient faire de grands progrès grâce à la mise en service de bateaux à vapeur. En octobre 1808, un mécanicien nommé Tilorier, inventeur d'une machine à remonter les bateaux contre le vent et le courant, avait obtenu l'autorisation de faire des essais au pont de Chatou.
L'armateur du bateau à vapeur l'Elise, M. Andeil, qui avait fait le 18 mars 1816 le voyage de Newhaven au Havre, après une traversée de 17 heures par vent et mer contraire, remonta la Seine jusqu'à Paris. Ces essais de navigation intérieure avaient attiré l'attention du Ministre de la Marine et des Colonies qui les encouragea. En avril l'Elise manœuvra plusieurs fois entre le Pont-Royal et le Pont des Arts devant une foule de curieux ; plusieurs officiers de marine, ainsi que les pages du Roi, visitèrent le navire qui se rendit ensuite à Rouen. La célérité du voyage qui, interrompu par le brouillard, ne dura en réalité que 24 heures surpassa toutes les espérances. L'on pensa à faire faire à l'Elise le trajet de Rouen à Elbeuf. L'administration de la navigation accélérée projeta alors d'établir sur divers points de la Seine des chantiers de construction.
Le 30 avril 1817 une ordonnance du Roi autorisait les sieurs Meynard et Cie, entrepreneurs des coches de la Haute-Seine, à établir sur la Basse-Seine des galiotes destinées au transfert des voyageurs de Paris à Rouen et vice-versa. Les bateaux à vapeur devaient servir seulement à les remorquer et ne porter sous aucun prétexte ni voyageurs ni marchandises. Ils avaient la priorité pour le passage aux ponts et pertuis et permission de trémater toute embarcation dont la marche serait moins accélérée.
Par la suite les passagers prirent place sur le bateau même.
Le Moniteur Universel du 27 juillet 1825 annonça que "Le Parisien" construit par M. Guibert à Mantes, à qui l'on devait les premiers bateaux à vapeur qui naviguèrent sur la Loire, venait d'être acheté pour faire la traversée de Paris à Saint-Cloud. Il était venu de Nantes au Havre par mer, ce qui était une garantie de sa solidité. Après avoir remonté la Seine jusqu'à Paris, il fit quelques voyages sur la Haute-Loire et ces essais ayant été bien accueillis par les riverains, il était permis d'espérer que la navigation à vapeur ne tarderait pas à s'établir dans cette direction.
En janvier 1829, La Caroline faisait le service entre Poissy et Rolleboise ; étant donné sa petitesse et son peu de largeur elle ne devait embarquer que 80 à 100 personnes.
L'équipage comprenait le propriétaire, le capitaine, un mécanicien chauffeur, deux pilotes, un marinier chargé d'aller chercher et mettre à terre les voyageurs et un aide. Les débuts n'avaient pas été heureux, car elle fit naufrage un soir contre l'île de Limay ; elle reprit toutefois son service.
Le Commerce de Paris, La Seine, L'Hirondelle, Le Casimir, appartenant à une compagnie anonyme remorquaient en 1834 des bateaux chalands et transportaient même environ 300 passagers par an.
| Vers
1836 le nombre des bateaux à vapeur augmente sur la Basse-Seine,
Le Théodore, La Ville de Paris, La Dorade, naviguent entre Maisons sur
Seine et Poissy ; Le Corsaire entre Paris, Maisons
et Rouen ; La Ville de Rouen entre Paris
et Rouen. Sur la Haute-Seine, La Ville de Corbeil, Le Parisien, La Parisienne, Le Luxor, L'Aigle, L'Hirondelle n° 1 vont de Paris à Corbeil, Melun et Montereau ; La Ville de Meaux de Paris à Meaux. |
La Seine à Poissy en 1836 |
Sur chacun le nombre de passagers variait de deux cent cinquante à trois cents. La Ville de Corbeil et Le Parisien en transportaient trente mille par an. La longueur des navires allait de trente à trente trois mètres ; la largeur de trois mètres cinquante à quatre. La vitesse maxima était de cinq lieues à l'heure en descendant et de trois en montant. Il est à remarquer que certains appareils à moteur provenaient d'Angleterre.
Ce fut par la Seine que le Duc de Nemours revenant de la glorieuse expédition de Constantine rentra à Paris ; il arriva au Havre le 8 décembre 1837. S'étant cassé le bras gauche au cours de la traversée et ne pouvant supporter la voiture, il s'embarqua sur Le Courrier qui le conduisit à Rouen d'où L'Union le ramena dans la capitale.
A cette époque l'entrée et la sortie des voyageurs étaient assez dangereuses car elles s'opéraient la plupart du temps à l'aide de batelets que les flots soulevaient parfois d'une manière inquiétante et il en résultait souvent des bains forcés ; il devint donc indispensable de généraliser et d'imposer la construction d'embarcadères plus nombreux.
En 1839, les bateaux des deux entreprises Les Etoiles et Les Dorades partant à la même heure du Pecq, pour Rouen faisaient de si grands efforts pour se gagner l'une et l'autre de vitesse que l'on craignait des accidents. Ils s'arrêtaient à Maisons-Laffitte, Conflans, Herblay, Poissy, Triel, Meulan, Mantes, Rolleboise, La Roche-Guyon – Bonnières. Les départs avaient lieu tous les matins. Il était impossible d'indiquer l'heure d'arrivée différente de la descente et à la montée, variant du reste chaque jour puisqu'elles étaient subordonnées à la vitesse des différents modèles en service, aux eaux plus ou moins fortes et à la difficulté du passage des ponts. Le mauvais état du fleuve causait souvent des attentes pour livrer passage aux bateaux de commerce engagés sous un pont où une seule arche était navigable
Les Dorades et les Etoiles furent employées pour la cérémonie du retour des cendres de l'Empereur. L'Oise, La Ville de Compiègne allaient en 1841 du Pecq à Soissons.
L'Education sentimentale de G. Flaubert débute par une description très pittoresque d'un départ :
|
Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, La Ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine ; des barriques, des câbles gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait, les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par les plaques de tôle, enveloppant tout d'une nuée blanchâtre tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Enfin le navire partit….. A part quelques bourgeois, aux premières, c'était des ouvriers, des gens des boutiques avec leurs femmes et leurs enfants. Comme on avait la coutume alors de se vêtir sordidement en voyage, presque tous portaient de vielles culottes grecques ou des chapeaux déteints, de maigres habits noirs, râpés par le frottement du bureau ou des redingotes ouvrant la capsule de leurs boutons pour avoir trop servi au magasin ; ça et là, quelque gilet à châle laissait voir une chemise de calicot, maculée de café ; des épingles de chrysocale piquaient des cravates en lambeaux ; des sous-pieds cousus retenaient des chaussons de lisière ; deux ou trois gredins qui tenaient des bambous à gaine de cuir lançaient des regards obliques, et des pères de familles ouvraient de gros yeux, en faisant des questions. Ils causaient debout ou bien accroupis sur leurs bagages ; d'autres dormaient dans les coins, plusieurs mangeaient. Le pont était sali par des éclats de noix, des bouts de cigares, des pelures de poires, des détritus de charcuterie apportée dans du papier ; trois ébénistes, en blouse, stationnaient devant la cantine ; un joueur de harpe en haillon se reposait, accoudé sur son instrument, on entendait par intervalles le bruit du charbon de terre dans le fourneau, un éclat de voix, un rire, et le capitaine sur la passerelle, marchait d'un tambour à l'autre sans s'arrêter ... |
Ces diverses entreprises ne purent lutter avec le chemin de fer, perdirent peu à peu de leur importance et se trouvèrent réduites vers 1845 au service de la Haute-Seine. En 1855 Le Paquebot n° 2 faisait encore le trajet Paris – Melun et Le Riverain n° 1 Paris – Montereau.
Des précisions nous sont apportées par l'Association Sequana, qui présente également sur son site Web le développement de la navigation de plaisance à vapeur :
Dés 1826, 20 bateaux à vapeur circulaient sur la Seine. A partir de 1836, des vapeurs faisaient le service de Paris à Rouen ; le Pecq est devenu le départ des descentes de la Seine jusqu'au Havre en 1837, après l'ouverture de la ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye.
Les Dorades et les Etoiles partaient chaque matin à 8 h et arrivaient à Rouen entre 18 et 19 h ; leur vitesse moyenne était de 18 km/heure (200 km de rivière en 10 h avec dix huit arrêts).
Les Dorades étaient mues par des machines à vapeur à haute pression de 40 chevaux, construites par François Cavé, mécanicien à Paris (214, rue de faubourg-Saint-Denis). D'origine modeste, il était ouvrier menuisier dans une fonderie. Doué d'un esprit curieux, observant la place grandissante de la vapeur dans l'industrie, il inventa la machine cylindrique oscillante, aux poids allégés et au coût de fabrication moindre. Le roi Louis-Philippe encouragea "le génie constructeur" en le décorant de la légion d'honneur en 1834.
Bientôt, le nombre de vapeurs augmentant, une ordonnance de Louis-Philippe du 23 mai 1843 réglementa la navigation des bateaux à vapeur sur les rivières et fleuves de France.
L'essor de la batellerie (à partir de 1860)
|
A cette époque, le halage est l'unique moyen de traction des bateaux sur les rivières et les canaux. La mécanisation va permettre de développer de nouvelles techniques. |
 |
Le texte suivant est adapté d'une page du site Web du Club Historique d'Andrésy.
Le touage mis en œuvre en aval de Conflans vers 1860, et le remorquage à partir de 1880, ont révolutionné la navigation, principalement sur la Basse-Seine qui venait d'être canalisée par des barrages et des écluses.
Le touage
Le touage permettait à un bateau (le toueur) de se tirer lui-même sur une chaîne ou un câble fixe immergé dans le lit de la Seine. Le toueur pouvait entraîner d'autres bateaux. Il comportait une machine à vapeur qui entraînait le tambour d'enroulement du câble.
La difficulté principale résidait dans les croisements de deux toueurs circulant en sens contraire. Ils devaient s'opérer sur la même chaîne (ou le même câble) et exigeaient de désolidariser la chaîne ou le câble du tambour sur lequel elle était enroulée. L'invention du toueur à tambour électromagnétique assurera un peu plus tard une manœuvre plus sûre et plus rapide. Mais le toueur sera quand même détrôné par le remorqueur, beaucoup plus souple d'emploi.
Le remorquage
 |
A partir de 1880, des remorqueurs à vapeur, ressemblant aux remorqueurs maritimes de la Manche et de l'estuaire de la Seine, ont été utilisés pour la navigation fluviale. Ils avaient des cheminées qui s'abaissaient pour passer sous les ponts et crachaient une épaisse fumée. |
Alors que le halage se contentait de relais pour les chevaux, toueurs et remorqueurs avaient besoin de ports, d'ateliers de réparation et de révision, de bureaux de gestion.
 |
Des remorqueurs, qui naviguaient sur la Seine, sont conservés par le musée de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine ou y servent d'habitation à d'anciens mariniers. |

|
Nuisances sonores de la navigation à vapeur
Des riverains de la Seine ont alors mené le même combat que les Franciliens d'aujourd'hui contre les nuisances des moyens de transport. Vers 1895, ce n'étaient pas les avions mais les bateaux à vapeur qui troublaient leur tranquillité : leur sifflet de forte puissance produisait un bruit discordant et intolérable, épouvantant les animaux au risque de causer des accidents fâcheux. De nuit, l'emploi de ce sifflet était souvent réitéré et plus prolongé, aux approches des écluses, pour réveiller l'éclusier.
De plus, la fumée produite par les bateaux à vapeur était épaisse et nauséabonde, leur combustible étant de mauvaise qualité. La longueur des convois de bateaux et leur stationnement fréquent en dehors des lieux réglementaires causaient une grave entrave pour la petite batellerie et la navigation de plaisance.
Un avocat d'Ablon-sur-Seine s'est notamment plaint au ministre des Travaux Publics. Cliquez ci-après pour lire son mémoire en faveur des populations riveraines de la Seine contre les abus de la navigation à vapeur, présenté sur le site Web de l'Association de Recherches Historiques en Val de Seine, Val d'Ecole, Pays de Bière, Gâtinais Français.
Le transport fluvial à Villennes
|
Au vingtième siècle, les villennois éventuellement gênés par le transport fluvial étaient les riverains du chemin de Seine, face à l'île du Platais, ainsi que certains habitants de l'île de Villennes. En effet celle-ci se situe entre le grand bras de la Seine, où circulent les péniches, et la plus grande partie du village. |
 |
 |
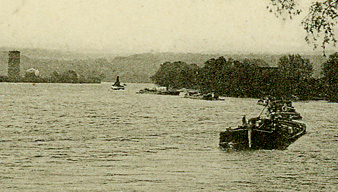 |
 |
Depuis longtemps, il n'y a plus de touage ni halage ; les péniches se déplacent par leurs propres moyens. Parfois, elles transportent l'automobile de leur propriétaire. |
Pour aller plus loin dans l'histoire du transport fluvial, nous vous proposons de visiter deux sites Web :